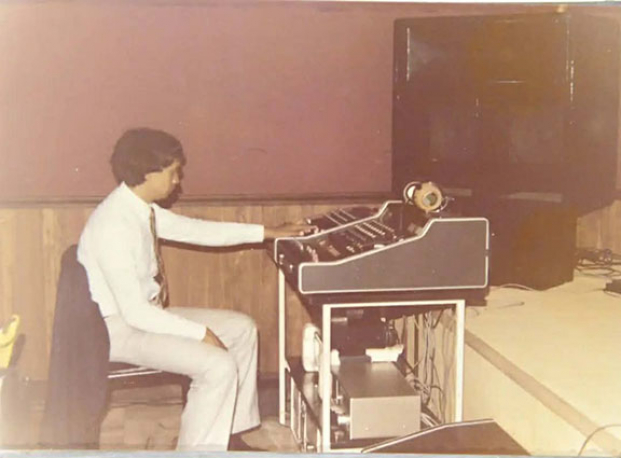Le textile, à Madagascar, n’est pourtant pas une activité comme une autre. C’est une matrice sociale, un héritage culturel et un pilier industriel. Il façonne la vie de centaines de milliers de familles, structure des quartiers entiers autour des zones franches, et sert de porte d’entrée sur le marché mondial. Les ateliers, qu’ils soient artisanaux ou industriels, ne produisent pas seulement des vêtements ; ils tissent aussi des histoires, des solidarités et, pour beaucoup, l’espoir d’un emploi stable, même modeste.
Depuis le 7 août 2025, l’administration américaine a imposé un tarif douanier additionnel de 15 % sur les exportations malgaches, dont le textile, jusque-là exonérées grâce à l’African Growth and Opportunity Act ou AGOA. Ce taux, bien qu’inférieur aux 47 % envisagés en avril, marque une rupture avec le régime préférentiel en vigueur depuis deux décennies. A quelques semaines de l’expiration officielle de l’AGOA (prévue le 30 septembre) et dont la suite reste incertaine, le secteur textile malgache entre dans une zone de turbulence commerciale sans précédent.
Or, grâce aux accords commerciaux préférentiels comme l’AGOA, avec les Etats-Unis, et le régime « Tout sauf les armes » et APE avec l’Union européenne, Madagascar s’est imposé comme l’un des poids lourds africains du textile. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2024, les exportations vers les Etats-Unis ont rapporté 406 milliards d’ariary, soit environ 206 millions de dollars, plaçant le pays au troisième rang des fournisseurs africains derrière le Kenya et le Lesotho. Vers l’Europe, elles ont atteint 176 milliards d’ariary, environ 89 millions de dollars, faisant de Madagascar le premier fournisseur textile d’Afrique subsaharienne sur ce marché. Au total, les exportations textiles se sont élevées à 887 milliards d’ariary, soit près de 447 millions de dollars, un montant qui illustre la place centrale du secteur dans l’économie nationale.
Ce dynamisme repose largement sur les zones franches industrielles, qui concentrent la quasi-totalité de la production destinée à l’exportation. Ces zones, notamment à Antananarivo et à Antsirabe, accueillent des dizaines d’usines opérant pour le compte de marques internationales. En 2024, plus de 400 000 personnes travaillaient dans le textile, dont environ 200 000 dans les zones franches, avec une très forte majorité de femmes. Pour beaucoup, c’est le premier emploi formel, parfois le seul, et il constitue un revenu vital pour la famille élargie. Le pays attire des investisseurs étrangers séduits par la main-d’œuvre abondante et compétitive, ainsi que par la position stratégique de Madagascar dans les chaînes de sous-traitance mondiales.
Pourtant, derrière cette réussite se cache une réalité moins reluisante : Madagascar importe bien plus de vêtements qu’il n’en exporte. En 2024, les importations de vêtements made in China ont atteint 1 735 milliards d’ariary, soit presque le double des exportations. La friperie européenne de son côté a représenté 61 100 tonnes pour une valeur CAF de 395,3 milliards d’ariary. En additionnant tous ces flux, le déficit textile atteint 1 240 milliards d’ariary, un gouffre qui illustre à quel point le marché intérieur est dominé par les produits importés. Ce déficit contribue à l’érosion des réserves en devises et pèse sur la balance commerciale globale, déjà très déficitaire. En 2024, le déficit commercial du pays s’est établi à 6 943 milliards d’ariary, en hausse de près de 65 % par rapport à 2023, et le textile en représente à lui seul près d’un cinquième.
Ce dossier propose d’explorer les enjeux économiques, sociaux et culturels du textile à Madagascar, en mettant en lumière les chiffres clés, les dynamiques d’exportation et d’importation, les conditions de travail, et les perspectives industrielles. Car comprendre ce paradoxe, c’est aussi poser les bases d’une stratégie textile plus équitable, plus résiliente, et plus enracinée dans les réalités malgaches.
L’AGOA : levier stratégique ou dépendance risquée ?
Depuis son adhésion au programme américain African Growth and Opportunity Act (AGOA) en 2001, Madagascar a vu son secteur textile se transformer en pilier industriel et social. Ce régime préférentiel, qui permet l’exportation de plus de 1 700 produits vers les Etats-Unis sans droits de douane ni quotas, a été un catalyseur de croissance. En 2024, près de 206 millions de dollars de vêtements malgaches ont été exportés vers le marché américain, représentant 37,7 % des exportations textiles du pays. Cette performance place Madagascar au troisième rang des fournisseurs africains de vêtements aux Etats-Unis, derrière le Kenya et le Lesotho.
Mais cette réussite repose sur une fragilité structurelle. L’AGOA, dont l’échéance actuelle est fixée au 30 septembre 2025, pourrait ne pas être reconduit dans sa forme actuelle. Les discussions au Congrès américain sont marquées par des tensions géopolitiques et une volonté de refonte du programme. L’administration Trump, dans une logique protectionniste, envisage de durcir les conditions d’accès, notamment en remettant en question la disposition dite “Third Country Fabric” (TCF), qui autorise les pays bénéficiaires à s’approvisionner en tissus dans n’importe quel pays tiers, notamment en Asie.
Pour Madagascar, cette clause est vitale. Le pays ne dispose que d’une seule usine de tissage opérationnelle, avec des capacités limitées. La suppression du TCF obligerait les industriels à produire localement leurs tissus, ce qui est irréalisable à court terme. Les infrastructures énergétiques sont instables, les coûts de production élevés, et la chaîne de valeur du coton reste embryonnaire. En 2024, moins de 5 % des tissus utilisés dans les usines malgaches sont produits localement. Le reste provient principalement de Chine, du Pakistan et d’Indonésie.
L’enjeu humain est colossal. L’AGOA a permis la création de plus de 200 000 emplois directs dans le textile, dont une majorité de femmes. Ces ouvrières, souvent jeunes et peu qualifiées, ont trouvé dans les usines franches une source de revenu stable, même si les salaires restent modestes – autour de 250 000 ariary par mois. La suppression de l’AGOA ou la fin de la clause TCF provoquerait une vague de fermetures d’usines et plongerait des dizaines de milliers de familles dans une précarité encore plus grande. Les zones franches, qui concentrent près de 50 % des cotisants à la CNaPS, jouent un rôle clé dans la formalisation du travail à Madagascar.
Mais au-delà des chiffres, l’AGOA a aussi façonné une culture industrielle. Il a permis l’émergence de savoir-faire, la structuration de filières, et l’ouverture vers des marchés exigeants. Il a aussi révélé les limites du modèle : dépendance aux intrants étrangers, vulnérabilité aux décisions politiques extérieures, et faible intégration locale. En 2025, Madagascar se trouve face à un dilemme : comment préserver les acquis de l’AGOA tout en construisant une industrie textile plus autonome, plus inclusive et plus résiliente ?
Ainsi l’AGOA n’est pas seulement un accord commercial. C’est un levier de développement, mais aussi une dépendance stratégique. Sa reconduction, espérée jusqu’en 2045, offrirait une bouffée d’oxygène. Mais elle ne saurait remplacer une politique industrielle nationale ambitieuse, capable d’intégrer les artisans du « zaitra an-tsena », de réguler les importations de textile chinois, et de valoriser les ressources locales.
Le marché européen : un levier stratégique
Alors que les Etats-Unis imposent depuis le 07 août 2025 une taxe additionnelle de 15 % sur les textiles malgaches, l’Union européenne réaffirme son rôle de partenaire commercial stable et prévisible. Le textile représente environ 30 % des exportations malgaches vers l’Europe, selon les données du Comité interministériel AGOA et du FMFP.
Roland Kobia, ambassadeur de l’Union européenne à Madagascar a déclaré lors de la Journée des projets à l'université d’Antananarivo le 21 mai dernier : “L’Union européenne offre depuis de longues années un régime commercial extrêmement favorable aux exportations malgaches, avec 0 % de droits de douane et aucune restriction quantitative. Cela a été le cas hier, demain et encore après-demain. Les exportateurs malgaches n’ont rien à craindre du marché européen, et qu’ils peuvent augmenter leurs volumes autant qu’ils le souhaitent, à condition de respecter les nouvelles normes environnementales et sociales en vigueur à partir de 2027 (traçabilité, écoconception, devoir de vigilance), selon lui.
Cette ouverture a permis à Madagascar de devenir le premier exportateur de produits textiles d’Afrique subsaharienne vers l’Europe.
Les exportations vers l’Union européenne ont atteint 176 millions de dollars en 2024, avec des débouchés solides en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.
Grâce au régime “Tout sauf les armes” et à l’Accord de partenariat économique (APE) en vigueur depuis 2012, des milliers de produits malgaches — dont le textile — entrent dans l’UE avec 0 % de droits de douane et sans quotas. Ce régime permet à Madagascar d’exporter librement vers un marché de 450 millions de consommateurs, avec un fort pouvoir d’achat et des exigences croissantes en matière de durabilité.
Or, si l’Union européenne offre à Madagascar un accès douanier sans précédent — zéro droit de douane, absence de quotas, et reconnaissance dans le cadre de l’Accord de partenariat économique — les exportations textiles malgaches vers l’Europe restent étonnamment modestes. Ce paradoxe s’explique par une série de freins structurels, techniques et stratégiques.
D’abord, le manque de visibilité commerciale constitue un obstacle majeur. Les marques européennes, notamment dans les secteurs du prêt-à-porter et du textile technique, connaissent peu les capacités industrielles malgaches. Les salons professionnels internationaux sont rarement accessibles aux producteurs locaux, et les campagnes de promotion institutionnelle restent limitées. En l’absence de vitrine crédible, Madagascar peine à se positionner comme une alternative sérieuse face à des concurrents mieux organisés comme le Bangladesh, le Vietnam ou même l’Ethiopie.
Ensuite, les normes européennes deviennent de plus en plus exigeantes, notamment dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe. A partir de 2027, les produits textiles devront intégrer un “passeport numérique” retraçant leur origine, leur composition, leur impact environnemental et les conditions de production. Or, très peu d’entreprises malgaches disposent aujourd’hui des outils de traçabilité, des certifications environnementales ou des audits sociaux nécessaires pour répondre à ces critères. Ce déficit technique crée une barrière invisible mais redoutable à l’entrée sur le marché européen.
Par ailleurs, la structuration des chaînes de valeur locales reste insuffisante. La majorité des matières premières — fils, tissus, teintures — sont importées, souvent d’Asie, ce qui augmente les coûts et complique la traçabilité. Les ateliers de confection, bien que compétents, manquent souvent de formation sur les standards européens en matière de qualité, de sécurité et de durabilité. Cette fragmentation industrielle limite la capacité du secteur à répondre à des commandes complexes ou à garantir une production conforme aux attentes des donneurs d’ordre européens.
Enfin, le tropisme historique vers le marché américain, facilité par l’AGOA, a longtemps orienté les efforts malgaches vers les Etats-Unis. Ce choix stratégique, compréhensible à l’époque, a eu pour effet de retarder la diversification vers l’Europe. Aujourd’hui, avec l’introduction de nouvelles taxes américaines sur les textiles malgaches, cette dépendance devient un risque, et l’Europe apparaît comme une alternative stratégique. Mais les ajustements nécessaires — en matière de normes, de marketing, de logistique — ne peuvent se faire du jour au lendemain.
Friperie : entre débrouille populaire et défi industriel
Dans les rues de Mahajanga comme dans les quartiers d’Antananarivo, la friperie est partout. Des étals improvisés débordent de vêtements, linges de maison, jouets, ustensiles et textiles en tout genre. A partir de 500 ariary, parfois jusqu’à 50 000, chacun y trouve son compte. Ce marché informel, devenu pilier de la consommation urbaine et rurale, reflète une réalité économique : la majorité des Malgaches vit sous le seuil de pauvreté, et la fripe offre une alternative accessible.
Mais derrière cette vitalité se cache une dépendance croissante. En 2024, Madagascar a importé plus de 61 000 tonnes de friperies, pour près de 400 milliards d’ariary. Ces volumes, en hausse constante, saturent les marchés et fragilisent l’industrie textile locale. Les petits couturiers, autrefois dynamiques, peinent à survivre. Certains se reconvertissent, d’autres abandonnent.
La friperie n’est plus seulement un choix économique : elle devient une norme culturelle, portée par les réseaux sociaux et les plateformes de vente en ligne. Pourtant, cette tendance soulève des questions. Peut-on relancer une production textile nationale tout en laissant la fripe dominer ? Des mesures de régulation sont évoquées, mais l’équilibre reste précaire.
Ce marché, à la fois vital et invasif, illustre les tensions entre survie quotidienne et souveraineté industrielle. La friperie, loin d’être un simple commerce de seconde main, est devenue un miroir de la société malgache : inventive, résiliente, mais en quête de solutions durables.